L’esprit Gezi : La possibilité d’une impossibilité

L’esprit Gezi : La possibilité d’une impossibilité
(English version here)
par David Selim Sayers (Paris, France)
par Macha Matalaev (Paris, France – traduction française)
NOTE DES ÉDITEURS : Cet article a été publié le 8 janvier 2014 dans la revue en ligne Reflections on a Revolution (ROAR), dans le cadre d’un colloque intitulé « Reflections on the Gezi Uprising » (Réflexions sur le soulèvement de Gezi). Il est reproduit ici, avec l’aimable autorisation de ROAR, pour marquer le 10e anniversaire de l’occupation du parc Gezi.
L’occupation du parc Gezi a pris fin dans la nuit du 15 juin 2013, lorsque la police anti-émeute a évacué les manifestants par la force, utilisant des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour chasser les occupants dans l’hôtel cinq étoiles « Divan », qui jouxte le parc au nord. Ma femme et moi étions au cœur des manifestations depuis le 4 juin et faisions partie de la poignée de personnes, 200 tout au plus, à avoir passé la nuit dans le hall de l’hôtel assiégé, harcelés par la police, pratiquement coupés du monde extérieur et ne comprenant pas vraiment ce qui empêchait la police de faire irruption et de nous embarquer. Au lever du soleil, submergés d’épuisement et de dégoût, nous avons quitté l’hôtel, traversé les barricades et sommes rentrés chez nous. Personne n’a essayé de nous arrêter. Ce n’était pas la peine, l’occupation était terminée.
Après cette nuit, les manifestations se sont poursuivies de manière sporadique. Les habitants se sont réunis en assemblées de quartiers, tentant de recréer l’expérience de Gezi dans les parcs locaux et mettant en place des tribunes de parole pour poursuivre les discussions sur les questions soulevées lors des manifestations. Mais le moment révolutionnaire était clairement révolu. Le gouvernement AKP passa à l’offensive : plus de soixante journalistes furent démis de leurs fonctions pour avoir parlé des manifestations. Des citoyens furent arrêtés pour des délits aussi anodins que l’envoi de messages de soutien sur Twitter. La plupart des manifestants quittèrent le mouvement actif. Une atmosphère de peur et de paranoïa se répandit dans le pays et menaçait de resserrer encore son emprise sur la vie des citoyens.
Il n’y eut aucune révolution. Aucune destitution. Pas une seule démission dans les rangs de l’AKP. La police anti-émeute reçut des avantages et des salaires en récompense de ses efforts. Les négociations de la Turquie avec l’Union européenne, qui avaient été reportées en raison des événements, ont repris. Et l’AKP semblait en bonne position dans les sondages, aucune menace ne planant sur son avenir politique ni celui du premier ministre Recep Tayyip Erdoğan.
Bien sûr, la réputation démocratique du gouvernement AKP n’est pas sortie intacte de cette débâcle ; néanmoins, sa gestion de la crise paraît indulgente comparée aux anciennes juntes militaires turques, dont la plus récente – et la plus féroce – avait anéanti le mouvement d’opposition de gauche du pays et ouvert la voie à l’instauration d’un ordre économique néolibéral lors du coup d’État de 1980, au cours duquel des milliers de personnes ont été tuées, portées disparues ou arrêtées. Si c’est là la fin du soulèvement de Gezi, à quoi a-t-il servi ? Et pourquoi ce phénomène nous intéresse-t-il encore aujourd’hui ?
Et nous intéresse-t-il seulement ?
Pour répondre à cette question, il convient d’examiner deux aspects de la culture politique turque : d’une part, l’absence de contrôles institutionnels sur le pouvoir politique centralisé et, d’autre part, une tradition profondément ancrée de mener la vie politique en s’appuyant sur les divisions de la société. Dans ce court article, je me concentrerai uniquement sur ce dernier aspect.
L’avènement de l’État-nation
Parmi les traditions ancestrales de la politique turque figurent la division et la polarisation, héritées de l’Empire ottoman. L’empire, qui a été fondé vers 1300 et a survécu jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, est connu pour son caractère multiethnique et multireligieux. L’élite ottomane dirigeante constituait une strate sociale à part entière, prélevant les impôts, les biens et les ressources humaines de la population tout en restant relativement étrangère à la vie et au mode de vie de la majorité de ses sujets. Ces derniers étaient subdivisés principalement en fonction de leurs croyances religieuses, ce qui a donné naissance au système des millet, dans le cadre duquel des groupes ethno-religieux tels que les Juifs, les Arméniens orthodoxes, les Arméniens catholiques et les Grecs orthodoxes jouissaient d’un certain degré d’autonomie.
Il ne fait aucun doute que les Ottomans étaient impitoyables dans leur répression de toute menace perçue contre leur pouvoir, par exemple lors des massacres des Alévis perpétrés par Selim Ier, surnommé “le terrible” (qui régna de 1512 à 1520). Néanmoins, de nombreux groupes religieux ont bénéficié d’institutions semi-autonomes, telles que leurs propres cours de justice, où les litiges étaient réglés selon les normes de la religion en question. Dans une certaine mesure, les sujets jouissaient de la liberté de mouvement et de la liberté de conversion d’une religion à l’autre (à l’exception évidente de la conversion de l’islam). Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les dirigeants ottomans de l’empire n’ont pas tenté d’homogénéiser leur population.
Ce modèle s’est effondré avec l’avènement du nationalisme européen. L’Empire ottoman affaibli s’est peu à peu désintégré, remplacé par des États-nations qui étaient, dans la plupart des cas, des États clients de grandes puissances telles que la Russie, l’Autriche-Hongrie et la Grande-Bretagne. La mise en œuvre de politiques nationalistes sur les territoires d’un empire autrefois multiethnique, multilingue et multireligieux a entraîné une catastrophe démographique dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. Du génocide arménien au nettoyage ethnique des guerres yougoslaves, des pogroms anti-grecs de la Turquie des années 1950 à la guerre civile en cours en Syrie, toute la région s’est engagée, et s’engage encore, dans la tâche sisyphéenne de créer des États-nations homogènes à partir de ce qui a été une entité politique ethniquement et religieusement mélangée pendant plus d’un demi-millénaire.
Dans ce processus, le nationalisme turc était un phénomène après coup, une réaction aux autres nationalismes qui s’étaient développés autour du noyau de l’Empire ottoman. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le mot “Turc” signifiait pour les Ottomans un nomade grossier, semi-païen, sans aucune notion de civilisation et de culture. Mais lorsque l’empire s’est effondré, l’ethnie et la culture turques ont été “redécouvertes” et, dans une large mesure, réinventées, pour constituer une cohésion parmi tous ceux qui restaient après que les groupes ethnoreligieux eurent rogné l’empire autant qu’ils le pouvaient et que les grandes puissances se furent emparées de tout ce qui pouvait faire l’objet d’un accord.
Le nationalisme turc a été renforcé par des violentes politiques de nettoyage ethnique, la plus tristement célèbre étant la destruction de la communauté arménienne en Anatolie pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi l’échange de populations avec la Grèce en 1923. Environ 2 millions d’Arméniens ont été tués ou déplacés, et environ 1 million de personnes de confession grecque orthodoxe ont été expulsées de la nouvelle république turque. Malgré tous ces efforts, la population est restée hétérogène et les failles qui divisent aujourd’hui la société turque étaient perceptibles dès le début. Dès le début, les Kurdes représentaient environ 20 % de la population. Dès le début, les Alévis représentaient 20 % de la population. Dès le début, la majorité musulmane sunnite rurale était acquise. Et dès le début, l’État a favorisé l’émergence d’une élite urbaine, éduquée, militante, laïque et nationaliste.
Le régime turque « contre »
Depuis lors, la Turquie est divisée selon ces lignes de faille. L’élite laïque, composée de professionnels, de bureaucrates, d’officiers militaires, de citadins et de riches propriétaires terriens, a constitué la coalition qui a maintenu l’État turc à parti unique au pouvoir jusqu’à ce qu’il se fissure sous la pression de la Seconde Guerre mondiale. La majorité sunnite est courtisée par les partis populistes depuis les premières élections démocratiques en Turquie en 1950, au détriment des minorités et de la gauche turque en difficulté. La gauche a cherché à unir les groupes ethniques tout s’opposant fermement aux islamistes. Les Kurdes ont trouvé un terrain d’entente religieux avec la majorité tout en s’opposant à elle sur la question du nationalisme. Les Alévis se sont rangés du côté de l’élite laïque par crainte d’être persécutés et assimilés par la majorité sunnite.
Quiconque a gouverné la Turquie a toujours gouverné contre quelqu’un. Les laïques ont gouverné contre les islamistes dans les premiers temps de l’État. Depuis la guerre froide, les musulmans sunnites et les élites nationalistes ont gouverné ensemble contre la gauche. Le sentiment nationaliste a empêché tout parti au pouvoir, qu’il soit islamique ou laïque, de reconnaître les minorités telles que les Alévis et les Kurdes. Les chevauchements entre les groupes et les idéologies ont compliqué le tableau, faisant en fin de compte apparaître les divisions susmentionnées comme hypocrites.
Dans ce climat politique survolté, on pourrait dire que les soulèvements, les rébellions et les coups d’État occasionnels sont monnaie courante. Qu’est-ce qui rend donc le mouvement protestataire de Gezi différent ou particulier ?
Peut-être n’était-il pas du tout différent ni particulier. Peut-être s’agissait-il simplement d’une répétition de tendances déjà bien établies dans le corps politique turc. Le Premier ministre Erdoğan s’est empressé d’accuser les laïques d’être à l’origine du mouvement, affirmant que leur objectif était de provoquer un coup d’État militaire, dans le plus pur style turc, en chassant par la force le gouvernement légitimement élu de l’AKP. Et lorsque la police a repris la place Taksim aux occupants le 11 juin, la justification a été que des images d’Abdullah Öcalan, chef emprisonné du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), étaient accrochées tout autour de la place : le gouvernement ne pouvait pas laisser passer une telle insulte à la nation turque. Les vieilles lignes de fracture se réveillèrent : religieux contre laïcs, nationalistes contre Kurdes. Même le conflit entre sunnites et Alévis est intervenu : la grande majorité des personnes tuées lors des manifestations étaient des Alévis, ce qui suggère que les groupes Alévis de la population protestaient, et étaient réprimés, avec une véhémence particulière.
La possibilité d’une impossibilité
C’est vrai : beaucoup des manifestants du soulèvement de Gezi ont convergé vers le parc Gezi sous la bannière d’un mouvement ou d’un autre. Les laïques étaient présents en force, tout comme les Kurdes et les Alévis. Cela n’avait rien d’exceptionnel. Ce qui l’était, c’est qu’en arrivant sur place, ils se sont rencontrés. Et qui plus est, ils ont également rencontré des militants LGBT. Ils ont rencontré des musulmans sunnites anticapitalistes. Ils ont rencontré des supporters de football de tous les horizons politiques. Ils ont rencontré des gens dont ils étaient séparés par leur mode de vie et leur vision du monde, mais avec lesquels ils étaient unis dans leurs griefs contre la violence d’État que l’AKP faisait peser sur tous les groupes de manière égale. Et cette rencontre a produit une révélation.
La révélation a été stupéfiante pour moi. J’avais grandi autour du parc Gezi. Mes grands-parents, véritables enfants de la révolution kémaliste, m’avaient élevé à l’ombre de la tour de Galata, le point le plus au sud de l’avenue Istiklal, la zone piétonne emblématique d’Istanbul menant à la place Taksim. Voir des drapeaux kurdes hissés sur cette place à côté de bannières représentant Atatürk, entendre des militants LGBT protéger des sunnites en prière de la pluie, le tout dans une zone temporairement libérée du contrôle de l’État, c’était plus qu’une simple utopie. C’était quelque chose qui ne m’avait jamais effleuré l’esprit. C’était comme voir une nouvelle couleur pour la première fois, comme apprendre la première lettre d’un alphabet inconnu, comme découvrir que j’avais vécu dans la Matrice. Pour reprendre les mots de ma femme Evrim Emir-Sayers, docteure en philosophie, c’était « la possibilité d’une impossibilité ».
Pendant l’occupation et les semaines qui ont suivi, ces groupes disparates de manifestants ont appris à respecter l’espace et les opinions de chacun, ont participé à des marches pour les causes de chacun, se sont moqués des clichés idéologiques de chacun et ont cessé de s’en remettre aux lignes de faille traditionnelles de la politique turque pour déterminer leurs alliés et leurs ennemis. Les divisés et gouvernés de la Turquie ont compris que ce qui les gouvernait, c’étaient leurs préjugés, et que la seule chose qui pouvait les unir était d’exiger le respect, non seulement de leurs propres droits, mais aussi des droits de ceux qui manifestaient juste à côté d’eux.
Le soulèvement de Gezi est terminé. Les gens se sont retirés du parc Gezi et, dans une large mesure, derrière leurs barricades idéologiques habituelles. Il n’y a rien d’étrange à cela. Après tout, aucune des personnes présentes au parc ne pouvait prévoir ce qui l’attendait. L’ « esprit Gezi » a pris tout le monde par surprise et s’est évanoui avant que la leçon n’ait pu être assimilée. L’occupation de Gezi n’est pas tant un événement passé qu’une vision, un moment où la société turque a brièvement entrevu quelque chose qui n’existe pas encore. La question de savoir si cette vision se concrétisera un jour reste ouverte. Mais elle a suffi à transformer un spécialiste de la littérature ottomane en prose non occidentalisée comme moi en un activiste politique. Et si cet exploit peut être accompli, tout est possible.
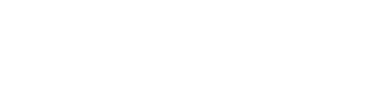

Responses