Petite causerie entre amis : Quelques pensées intempestives sur l’élasticité, la résistance, l’autre comme soi-même et la saveur de vivre

Image tirée de « The Tour of Dr. Syntax in Search of the Picturesque » de Thomas Rowlandson et William Combe (1813)
« Petite causerie entre amis » : Quelques pensées intempestives sur l’élasticité, la résistance, l’autre comme soi-même et la saveur de vivre
Interview avec Jörg Eschenauer
(English version here)
(Deutsche Version hier)
par Jörg Eschenauer (Aix-en-Provence, France)
NOTE DES ÉDITEURS : Cet article est basé sur un discours prononcé par le président de l’association PICT, Jörg Eschenauer, à l’École Nationale des Ponts et Chaussées à l’occasion de sa réception de l’Ordre des Palmes académiques.
Jörg Eschenauer français (JEF) : Cher collègue et ami, je te remercie de bien vouloir te prêter au jeu de cette causerie à l’occasion de la fin de ton parcours professionnel. Comment vas-tu au moment de quitter tes fonctions à l’Ecole des Ponts après 18 ans de loyaux services ?
Jörg Eschenauer allemand (JEA) : J’ai l’impression de me trouver comme sur un col de passage qui sépare deux versants de ma vie. La vie professionnelle dans mon dos et une nouvelle forme de vie active devant moi. En regardant en arrière je vois mon parcours dans son ensemble, avec ses bifurcations et ses lignes parfois droites et parfois remplies de virages, avec ses montées et ses descentes plus ou moins raides. Est-ce que cette perception d’une vie condensée et non linéaire, où tout se retrouve comme une seule entité dans mon esprit, est ce que Bergson appelle “la durée” ? Peut-être …
Ce moment unique de lâcher-prise et de transition vers une vie plus contemplative est en tous cas l’occasion de faire un bilan et d’exprimer ainsi ma gratitude. Si dans une telle situation de départ je suis bien obligé de parler, entre autres sujets, de ma personne, je n’ose le faire qu’à une seule condition. Connais-tu cette expérience curieuse que procure la prise de recul vis-à-vis soi-même ? En avançant dans la vie, on commence à se voir « soi-même comme un autre », pour le dire avec la belle formule de Paul Ricœur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Rimbaud m’avait si fortement touché avec sa fameuse phrase « JE est un autre ». Le J et le E étant les initiales de mon nom, je me suis toujours senti particulièrement visé.
JEF : Tu parles de gratitude, ce qui laisse entendre que tu conçois ta vie comme un cadeau. Que dirais-tu alors de cette vie en l’observant avec ce double regard sur toi-même, comme si tu étais un autre ?
JEA : La langue allemande dispose d’un mot très fort pour exprimer cet événement, lorsque quelque chose nous affecte indépendamment de notre volonté ou notre contribution. « Widerfahrnis » est un incident, un événement qui “vient à notre rencontre”. Nous ne sommes jamais seul maître à bord du bateau de notre existence. Ce qui nous arrive malgré nous peut être aussi bien une expérience tragique, comme une maladie, qu’une expérience heureuse qui nous apporte du bonheur et ouvre des perspectives prometteuses. J’ai beaucoup de raisons de ressentir cette profonde gratitude.
JEF : A qui s’adresse cette gratitude ?
JEA : Il s’agit tout d’abord d’une gratitude envers la vie qui m’a fait cadeau d’un parcours très varié avec des rebondissements totalement improbables. Puis-je me permettre une petite digression biopoétique ?
JEF : Je t’en prie. Sens-toi libre d’improviser. Nous sommes en France, après tout. Notre conversation n’est qu’une petite causerie, n’est-ce pas ? Mais que veux-tu dire par « biopoétique » ?
JEA : J’appellerai « biopoétique » toute tentative de conférer un sens poétique à sa vie, à sa biographie. C’est l’opposé du « storytelling » tellement à la mode aujourd’hui. Le storytelling met en avant nos exploits, notre réussite sociale, notre personne comme modèle à suivre. Une lecture biopoétique de notre vie fait exactement le contraire : elle illustre le côté surprenant de notre vie, notre irréductible singularité et tout ce qui nous est arrivé, sans que le moindre mérite ne nous revienne. Prenons par exemple mon nom, que je n’ai évidemment pas choisi. Mon nom de famille, Eschenauer, se traduit en français : « l’homme qui vit à la clairière des frênes », or je suis né dans la ville d’Aue (en Saxe) qui signifie justement « clairière ». 68 ans plus tard, je me retrouve à Aix-en-Provence, une autre ville à trois lettres commençant par un A. “Aix” veut dire “source d’eau”. Quelle belle cohérence biopoétique, n’est-ce pas ? Cette cohérence a émergé sans le moindre dessein préalable de ma part, mais sous l’impulsion d’une multitude de petites et grandes décisions prises face aux opportunités que la vie m’a offertes ! Je n’ai pas mené une vie toute tracée, bien au contraire. A aucun moment, au cours de cette randonnée qu’est ma vie, je n’ai su, ni même entraperçu, quel serait finalement “mon” col de passage à la fin de ma vie professionnelle.
JEF : Tu as quitté l’Allemagne pour t’installer en France dans les années 80.
JEA : Oui, c’était en 1984. Comme disait Freud, dans le meilleur des cas (et c’était heureusement le mien) c’est l’amour et/ou le travail qui font bouger les gens. J’étais vraiment enchanté de pouvoir apprendre la langue française en vivant en immersion à Paris intramuros entre 1984 et 1992. Je travaillais à l’époque pour une organisation protestante allemande située à Berlin-Ouest qui proposait aux jeunes adultes allemands d’effectuer un service civil de 18 mois dans un pays ayant souffert des atrocités commises par l’occupant nazi pendant la guerre. Nous étions à l’époque des précurseurs du volontariat européen qui s’est construit sur le modèle de ce type de service civil. C’est pendant ces années-là que j’ai eu la chance de découvrir une société française composée de femmes et d’hommes admirables, humanistes, solidaires, engagés et créatifs. Mes différentes activités professionnelles m’ont permis de sillonner tous les milieux sociaux, depuis un lieu d’accueil des personnes âgées comme les Petits Frères des Pauvres en passant par le mémorial de la Shoa jusqu’au Lycée international de Sèvres, l’Ecole Polytechnique et l’Ecole des Ponts où j’ai enseigné pendant une trentaine d’années l’Allemand et l’Histoire.
JEF : Aujourd’hui, avec le recul, que dirais-tu de ton intégration dans la société française ?
JEA : En tant qu’observateur « persan » on perçoit des choses qu’un autochtone n’aperçoit pas. Cette immersion dans une autre société, dont je ne maîtrisais pas encore la langue, m’a poussé à porter un regard d’ethnologue sur le comportement des personnes que j’ai eu l’occasion de fréquenter. Il me fallait cultiver ce regard pour être juste avec les autres et aussi pour ne pas me perdre moi-même avec ma différence. C’est certainement là le point d’origine de mon intérêt pour la dimension interculturelle de notre existence. Ma vie en France m’a donc beaucoup enrichi. Impossible de résumer ici, en quelques mots, l’ensemble de ces métissages que je considère aujourd’hui comme très profond et globalement plutôt réussi.
JEF : Raconte-nous au moins une expérience interculturelle qui t’a particulièrement marqué !
JEA : Je me limiterai alors à une seule anecdote qui en dit long sur la différence des cadres de référence culturels entre la France et l’Allemagne. Voici l’incident critique qui m’a d’abord choqué puis transformé dans le bon sens du terme. C’était au cours de l’hiver 1985/86, lorsque les températures sont descendues jusqu’à -20 degrés et que d’énormes stalactites de glace, tour à tour dégelant et gelant à nouveau, se sont agrandis pour atteindre une taille impressionnante d’un mètre et parfois plus grande encore. Un de ces blocs de glace s’étant écrasé sur le trottoir après sa chute du haut d’un immeuble parisien du 12e arrondissement, le jeune allemand soucieux des risques mortels potentiels d’une telle chute de glace que j’étais s’est précipité dans une parfumerie pour alerter la vendeuse du danger de mort qui planait au-dessus de sa tête si elle décidait de sortir sur le trottoir. Pendant que nous observions prudemment le bloc de glace au-dessus de nos têtes, un homme passant par-là nous dit simplement, en regardant vers le ciel : « De toute façon, il faut bien mourir un jour ! ». Je ne pouvais qu’être d’accord avec lui concernant notre inévitable finitude mais ce n’était pas du tout le moment pour moi de prendre le risque de mourir « ici et maintenant ».
Suite à cet incident, je méditais sur ce qu’une bonne dose de légèreté et de dérision « à la française » pouvait apporter à mon hyper-sensibilité morale d’un allemand né après-guerre. C’est un exemple de métissage réussi, même si je suis resté fondamentalement très attaché à une certaine rigueur éthique provoquée par l’histoire malheureuse de mon pays. J’ai appris à travers cet incident que l’autodérision et l’ironie bien dosées pouvaient être très salutaires pour ma vie personnelle de tous les jours. Ce n’est pas forcément la même chose pour les enjeux politiques de nos sociétés. 1986 est une année emblématique à ce sujet.
JEF : Pourquoi ?
JEA : C’est l’année de l’accident de Tchernobyl.
JEF : Je ne voulais pas trop en parler …
JEA : Je comprends. Ce n’est pas un chapitre très glorieux de l’histoire de l’intelligentsia parisienne qui s’est moquée éperdument de ces Allemands totalement irrationnels. Comment pouvait-on craindre, en étant sain d’esprit, que la radioactivité se retrouverait dans nos salades, à des milliers de kilomètres du lieu de l’accident ? L’Etat français a même empêché la publication des recherches qui confirmaient, peu de temps après la catastrophe, la contamination des champignons dans le Jura et jusque dans le sud de la France. Et puis la dérision à la française a de nouveau pris le dessus… Comme François Mitterrand avait refusé en avril 1986 le survol du territoire français par les avions militaires américains en direction de la Lybie, on disait que le président français avait bien évidemment aussi interdit le passage des nuages russes.
L’incident du bloc de glace du 12e arrondissement comme l’accident de Tchernobyl nous posent une question radicale : Que faire face au risque ? Ce n’est pas un hasard si deux livres incontournables sont parus à cette époque, écrits par deux auteurs allemands : Hans Jonas a publié en 1979 « Le principe responsabilité – Une éthique pour la civilisation technologique » et Ulrich Beck, en 1986 « La société du risque – Sur la voie d’une autre modernité ». Il fallait encore attendre quelques années avant que le « maître et possesseur (cartésien) de la nature » se soit cogné définitivement la tête contre le réel avec sa foi inconditionnelle dans le progrès scientifique et technologique.
JEF : L’Histoire avec un grand H joue un rôle très important pour toi. Est-ce que tu as été surpris par les différentes façons d’enseigner l’Histoire dans nos deux pays ? Qu’en penses-tu, en tant qu’allemand enseignant l’histoire dans le cadre de l’Éducation nationale française ?
JEA : Tu évoques là deux enjeux très, très importants dont on ne peut pas parler rapidement, au risque d’être mal compris. Dans le cadre de cette causerie, laisse-moi au moins dire ceci : je suis depuis toujours frappé par l’enseignement désincarné de l’histoire. Dans mon enseignement, j’ai pris en compte deux « histoires » qui sont inévitablement imbriquées : l’Histoire avec un grand H et l’histoire avec un petit h, c’est-à-dire l’histoire personnelle et familiale de mes élèves. J’ai appliqué dans mon enseignement le concept de « Eigengeschichte » de Wilhelm Schapp, un mot qu’on peut traduire par « histoire propre » qui caractérise la trajectoire propre de chaque être humain faisant partie de l’Histoire collective.
Schapp le dit ainsi : « Notre vie passée, située à l’intérieur des histoires du passé, est constamment autour de nous à la manière de l’horizon, sans que nous puissions même lever la tête hors de ce monde historique pour le regarder de l’extérieur. On ne le voit que comme la tête voit son corps, le corps auquel elle appartient. » Ce constat phénoménologique appliqué en pédagogie fait émerger un extraordinaire espace de résonance entre les différentes histoires « propres » des élèves d’un groupe-classe et permet ainsi une mise en perspective incarnée de l’Histoire. Il ne faut pas s’étonner dans la situation actuelle des choses que beaucoup d’élèves ne développent aucun intérêt vivant pour une Histoire qui est ressentie comme totalement éloignée de leur propre expérience.
Quelle était ta deuxième question ?
JEF : Dans ce contexte de l’Éducation nationale française, par quoi as-tu été le plus surpris ?
JEA : Là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire. Je me limite à un aspect qui devrait faire sourire aussi bien les Allemands que les Français pour équilibrer la balance. Demande aujourd’hui encore à un élève français qui a bien appris sa leçon d’histoire si Charlemagne était français. Il dira sans doute que Charlemagne était évidemment français. A quelques kilomètres de là, de l’autre côté du Rhin, l’élève allemand dira que Karl der Grosse était bien évidemment allemand. L’instrumentalisation de la figure de Carolus Magnus et de son Saint empire romain fonctionne encore aujourd’hui dans la fabrication du récit national fictif français, alors que nous savons qu’il est totalement absurde de projeter sur l’année 800 après J.-C. une sorte de prédestination de la nation française qui est née bien plus tard. Ni la France ni l’Allemagne n’existaient à cette époque.
En 2023, il serait peut-être temps de vider nos greniers idéologiques de ces visions nationales erronées et d’enseigner aujourd’hui l’histoire de l’Europe avec ses guerres civiles interminables et ces tentatives rares mais d’autant plus impressionnantes de fédération constructive. Carolus Magnus trouverait dans une telle perspective la place qu’il mérite, c’est-à-dire celle d’un précurseur ayant contribué à la naissance d’une certaine idée de l’Europe réunissant tous ses États dans une union supranationale. Mais qui veut encore bien voir aujourd’hui les enjeux de notre continent de cette façon ? Combien de guerres seront encore nécessaires pour que les gens comprennent enfin qu’une union forte est le seul destin viable pour les Européens ?
JEF : Souhaites-tu exprimer ta gratitude envers d’autres personnes ?
JEA : Je souhaite aussi exprimer ma gratitude envers mes parents et particulièrement envers mon père qui aurait tellement souhaité que je le suive sur ses traces professionnelles. Ingénieur passionné, professeur de mécanique et spécialiste de l’élasticité, il a construit des antennes paraboles partout dans le monde. Mais son fils était beaucoup plus attiré par les sciences de l’esprit que par les sciences de la matière. Sans vouloir heurter les ingénieurs, je dois avouer que je trouvais toujours ennuyeux le mutisme des sciences de la matière face aux questions éthiques essentielles que la vie nous pose. Dois-je adopter un enfant ? Dois-je me marier ? Dois-je m’engager dans la résistance contre une réalité sociale ou politique qui m’effraie ? Pour ce genre de questions, la première loi de la thermodynamique ne donnera jamais de réponse. La deuxième loi non plus, d’ailleurs. Les réponses à ces questions ne peuvent venir que du côté de Socrate, c’est-à-dire de la réflexion nourrie par les sciences de l’esprit, la philosophie, les Sciences humaines. Et ce sont exactement ces sciences-là qui exigent aujourd’hui des ingénieurs de faire des choix éthiques et sociétaux face aux enjeux technologiques et climatiques de notre époque.
Mon père a dû faire son deuil : « Mon unique fils ne sera jamais ingénieur ! ». Il avait lui-même collaboré avec des professionnels des sciences de l’esprit au travers de projets interdisciplinaires ambitieux, ce qui lui a permis de surmonter intelligemment cette « terrible épreuve ». C’est cette élasticité paternelle qui justifie ma grande gratitude. Pouvez-vous imaginer son « soulagement » et son sourire quand ce fils « ingrat » a finalement obtenu un poste dans une grande école d’ingénieur, même si ce n’était qu’en tant que « simple » représentant des sciences de l’esprit et enseignant de langue, d’Histoire et de Sciences politiques ? Pour réussir ce coup, il fallait émigrer en France où les Grandes Écoles imposent aux ingénieurs l’apprentissage de deux langues et donnent aux responsables d’un département le titre de « président », ce qui a tant impressionné mon père. Je contemple avec toujours autant d’émotion la photo de mes parents prise en 2007 devant l’entrée de l’École des Ponts. Mon père est décédé l’année suivante.
JEF : C’est curieux que le concept de l’élasticité semble former un trait d’union entre ton père et toi comme entre les sciences de la matière et les sciences de l’esprit.
JEA : J’ai effectivement été frappé de constater un jour que ce concept avait peut-être migré à mon insu des travaux de mon père vers ma réflexion sur les compétences interculturelles. C’est seulement après coup que j’ai réalisé qu’une transmission inconsciente m’avait fait cadeau de ce bel héritage.
JEF : La vie, tes parents … as-tu d’autres raisons d’être reconnaissant ?
JEA : Je suis aussi très reconnaissant envers la société française de m’avoir donné l’occasion, en tant qu’Allemand, de pouvoir répondre par mon engagement de citoyen-pédagogue aux délires des guerres du 20e siècle. Contribution tout à fait modeste mais claire : en 1914, ma grand-mère alors âgée de onze ans a perdu ses trois frères, morts au combat à quelques jours de distance. En 1980, elle vit d’un très mauvais œil l’apparition d’une jeune femme française à mes côtés. Heureusement, mes parents n’avaient plus de ressentiment mais la France était encore à ce moment-là un voisin lointain que l’on connaissait et comprenait assez mal dans ma famille. Je suis très heureux d’avoir contribué modestement, grâce à mes engagements personnels et professionnels, à une évolution constructive des relations franco-allemandes et de l’histoire européenne. Les langues ont joué un rôle important pour favoriser le transfert des connaissances et l’échange entre nos pays. L’Histoire continue. « Le présent est toujours la somme des futurs possibles », disait Raymond Aron. Aux plus jeunes d’œuvrer à présent pour la consolidation d’une Europe fière d’être fédéraliste et humaniste.
JEF : Après cet historique retour en arrière et la mise en perspective de ta vie, parle nous de ces dix-huit années passées à l’École des Ponts où tu as présidé le département Langues et cultures.
JEA : Pourquoi pas ? C’est vrai qu’on oublie tellement vite, surtout dans une époque où tout s’accélère d’une façon vertigineuse. On peut diviser mes années aux Ponts, entre 2004 et 2022, en trois phases. D’abord une phase de pacification qui était nécessaire, puisqu’il régnait en 2004 une atmosphère de méfiance très conflictuelle au sein du département. Je me rappellerai toujours du trouble que j’ai pu provoquer par la simple programmation d’une réunion de service pour tous les enseignants titulaires. On soupçonnait le nouveau responsable de vouloir annoncer des licenciements ! Tu peux imaginer mon étonnement !
La seule raison de cette réunion était la proposition d’organiser le congrès de l’Union des Professeurs de langue des Grandes Écoles (UPLEGESS) en 2006 aux Ponts, et j’étais assez naïf pour croire qu’un tel projet collectif suffirait à fédérer tous mes collègues. Le congrès a finalement eu lieu mais il a fallu que je puisse compter sur le soutien de la direction de l’époque pour stopper une cabale ad hominem organisée par certaines collègues. Cette cabale visait purement et simplement le licenciement de ce nouveau responsable de département. Les collègues détractrices à l’origine de ces agissements malveillants m’ont permis en revanche d’étudier en profondeur le phénomène psychologique de la projection.
La deuxième phase, de 2010 à 2014, était essentiellement consacrée à la mise en place d’une démarche Qualité authentique. Le département a alors posé des bases saines et stimulantes pour une démarche d’amélioration continue, encore valables aujourd’hui.
JEF : Pouvons-nous revenir un peu plus en détails sur cette phase de l’amélioration continue que tu définis comme une démarche « authentique » ? Que veut dire ce mot pour toi ?
JEA : C’est vraiment un point crucial. A quoi doit servir une démarche qualité ? Quelle est sa véritable finalité ? Comme c’est si bien dit dans la série « En thérapie » sur ARTE, nous vivons dans une époque où « tout est fragmenté dans un fantasme de perfection ». Ce genre de folie collective fait souffrir beaucoup de personnes. Barbara Stiegler a analysé brillamment ce « nouvel impératif politique » de notre société ultra-néolibérale actuelle : « Il faut s’adapter ».
En fait, le souci de qualité se présente maintenant sous deux formes opposées mais similaires à la surface de nos discours. Avec Valérie Darthout, qui était à l’époque responsable de la qualité aux Ponts, nous avons résumé un jour notre expérience en séparant clairement la démarche qualité authentique de la démarche purement cosmétique. La dernière ne vise que l’obtention d’un label en modifiant le moins possible la réalité du travail. Une démarche authentique a en revanche comme but une transformation de cette réalité en impliquant tous les acteurs de l’organisation et en leur procurant idéalement un bien-être ou tout du moins un mieux-être au travail. L’obtention du Label Qualité FLE était aussi le résultat d’un tel travail d’équipe solidaire.
Il n’y a pas beaucoup d’auteurs qui savent parfaitement résumer l’enjeu humain de la « qualité authentique ». Je tiens à renvoyer le lecteur vers le magnifique livre de Pascal Chabot « Traité des libres qualités » où se trouve ce constat lumineux : « Dans le cadre fortement contraint par notre âge technique, une philosophie ouverte aura à cœur de se recentrer sur les libres qualités, celles que l’on cultive pour la saveur de vivre. Car le défi de notre époque est bien d’articuler la valeur qualité aux exigences de liberté et aux besoins de justice. L’enjeu est de taille, pour peu que l’on veuille construire un monde commun, où les existences soient à même de prospérer. »
JEF : En effet ! On ne peut pas être plus clair et … clairvoyant ! Et une fois partie dans une démarche qualité authentique, comment caractériserais-tu la dernière phase ?
JEA : Les années de 2014 jusqu’à aujourd’hui sont les années de créativité et d’innovation pédagogique pendant lesquelles l’offre de cours de langues s’est diversifiée et a trouvé sa vitesse de croisière combinant le changement et l’ouverture vers des nouvelles pratiques pédagogiques tout en préservant ce qui avait fait ses preuves. C’était un signe fort de remplacer le nom très réducteur de ‘Département de la formation linguistique’ par ‘Département Langues et Cultures’. Toute l’équipe du DLC a mis beaucoup d’énergie, d’humanité et d’efficacité dans l’accompagnement de tous nos étudiants, français et internationaux !
L’attractivité des cours favorise aujourd’hui le développement de la créativité, de la confiance en soi et de la connaissance de l’autre dans l’usage de la langue « étrangère » sans négliger l’exigence linguistique visant un très bon niveau à l’écrit et à l’oral. Les mises en situation par les joutes oratoires, le théâtre, les approches corporelles et artistiques, les cours d’écriture créative, les cours sur l’expérience interculturelle et les tandems et bien d’autres types de cours ont fait leurs preuves. Les évaluations des cours de langues par les élèves et par la Commission des Titres (CTI) sont excellentes. Comment ne pas être un homme heureux quand on lit dans l’audit de la CTI que l’enseignement des langues est un des éléments forts de la formation aux Ponts ?
JEF : Quel pédagogue serait pour toi la référence incontournable, après tant d’années passées dans le milieu de l’enseignement ?
JEA : C’est difficile de répondre mais j’accepte le défi de cette question. Je conseillerais toujours à un/e jeune collègue de lire sans modération les livres de John Dewey.
JEF : Pourquoi ?
JEA : Dewey a mis au centre de son travail réflexif et pratique de philosophe mais aussi de pédagogue le phénomène de l’expérience. Ce n’est que l’expérience, et surtout celle de l’autonomie de l’apprenant, qui a une véritable puissance transformative et performative. Dewey a démontré de façon magistrale que les enjeux de l’éducation sont totalement indissociables de la démocratie. A une époque qui met à mal les fondements et les principes structurants de la démocratie pluraliste, la lecture de Dewey s’impose.
JEF : As-tu d’autres beaux souvenirs qui réchaufferont ton cœur pour le restant de ta vie ? Ou des projets qui te tiennent encore à cœur ?
JEA : Bien sûr. J’ai vraiment beaucoup apprécié ce bain plurilingue que représentait mon travail de tous les jours. Madame de Staël a dit : « Tout ce qui est naturel est varié. » Entendre à l’école quotidiennement un si grand nombre de langues et rencontrer tous les jours des enseignants d’allemand, d’anglais, d’arabe, de chinois, d’espagnol, de français, d’italien, de japonais, de portugais et de russe et pouvoir partager nos avis sur « Gott und die Welt » (‘Dieu et le monde’) comme le disent les Allemands était pour moi un plaisir extraordinaire. Je suis aussi très heureux d’avoir pu développer des projets à l’école comme les tandems mais aussi en dehors de l’école à l’UPLEGESS et à la Conférence des Grandes Écoles qui ont tous les deux contribué au rayonnement des Ponts. Je ne citerai que cinq exemples particulièrement emblématiques :
- Le congrès de l’UPLEGESS aux Ponts en 2006 sur le thème de l’internationalisation de nos formations avec une conférence inoubliable du philosophe François Jullien qui nous parlait de l’universel, de l’uniforme, du commun et du dialogue entre les cultures.
- La journée IDEA de 2016 « Apprendre, accompagner et former grâce au tutorat : Rôle et outils du « tuteur émergentiste ».
- Le colloque international en 2018 sur « la gouvernance linguistique des universités et établissements d’enseignement supérieur » coorganisé par l’Observatoire Européen du Plurilinguisme (OEP), l’Université Paris Diderot, l’École polytechnique, l’École des Ponts et l’UPLEGESS, l’Union des Professeurs de langue des Grandes Écoles.
- La mise en place du Programme pour Étudiants Réfugiés (PER) que notre département a lancé grâce à l’engagement déterminé, l’enthousiasme et le professionnalisme de l’équipe du DLC.
- Je suis aussi très heureux d’avoir pu participer récemment pour les Ponts à la production du MOOC de l’Institut Mines Télécom et de Télécom ‘Un carnet interculturel pour une mobilité universitaire’.
Enfin, j’ai encore le plaisir de préparer la publication d’un deuxième livre avec les Presses des Ponts. Il sera publié à la suite du premier portant le titre ‘L’ingénieur citoyen’ et réunira à nouveau plusieurs articles sur l’enjeu de l’apprentissage des langues pour l’ingénieur-manager de demain qui devrait être plurilingue.
JEF : En t’écoutant j’ai envie de te poser une question au sujet du management. Qu’est-ce que c’est pour toi : un bon manager ?
JEA : J’attendais que tu me poses une question de ce genre. Nous avons souvent discuté entre nous de ce que pourrait être une ‘bonne culture managériale’, n’est-ce pas ? Tu sais que je n’aime pas le mot ‘management’. Ses racines latines le rendent trop proche de la ‘manipulation’ et du ‘dressage’. Je me méfie énormément de toute forme de management pyramidale qui ne fonctionne pas sans cour et courtisans, autrement dit sans servitude volontaire. Le plasticien danois Olafur Eliasson a très bien résumé notre problème actuel : « Les gens ont perdu l’habitude du doute, on leur demande d’être affirmatifs, sûrs d’eux. Mais il faut aussi des gens qui ne sont pas sûrs ! » Il en faut pour permettre et installer systématiquement dans nos processus décisionnels le débat contradictoire, condition indispensable pour réduire au maximum le risque de prendre des « décisions absurdes » qu’a si bien analysé Christian Morel.
JEF : Quelle était ta boussole pour naviguer sur la mer agitée que représentait la coordination d’une équipe ?
JEA : Je me suis fixé comme but de créer un cadre qui soit à la fois suffisamment stable et suffisamment flexible pour permettre l’émergence d’un espace de créativité et de résonance au sein de notre équipe. « Encadrer » voulait dire pour moi entrainer, encourager, reconnaître afin d’imaginer ensemble de nouvelles choses et de les faire ensemble en les combinant intelligemment avec des pratiques pédagogiques qui ont fait leur preuve.
Je me voyais bien agir comme un tuteur émergentiste, seul rôle possible pour quelqu’un qui vise à insérer une équipe dans la dynamique du vivant. Pour jouer ce rôle en toute modestie, je me suis toujours posé la question : As-tu vraiment écouté ce qu’a dit l’autre ? Évidemment non, pas toujours, je n’ai pas toujours bien écouté mais je pense m’être amélioré. L’écoute précède le discours puisqu’il s’adresse toujours à un certain public dans un espace-temps bien spécifique. Avant de prendre la parole, ne faut-il pas d’abord écouter ? Chaque discours, n’est-il pas par essence une réponse qu’on adresse à quelqu’un ? Si enseigner les langues est le plus beau métier du monde, c’est parce qu’au fond, nous enseignons avant tout l’écoute active sans laquelle on ne peut pas apprendre à parler une nouvelle langue.
Nous avons intérêt à méditer le fragment 19 d’Héraclite : « Comme ils ne savent pas écouter, ils ne savent pas parler non plus. » Marguerite Yourcenar raconte dans « Mémoires d’Hadrien » une scène qui reflète le même enjeu : lors d’un voyage, l’empereur Hadrien est interpellé par une vieille femme. Fatigué, il se détourne et continue son chemin. Elle le retient alors et lui dit : « Si tu n’as pas le temps de m’écouter, tu n’as pas le temps de gouverner. » Voilà l’enjeu radical de tout discours : être avant tout le résultat d’une grande écoute !
JEF : Et de quel type de management te méfies-tu le plus ?
JEA : Du ‘management par le chiffre’ ! Avec les chiffres on peut tout faire. Les chiffres sont les outils préférés des dirigeants-manipulateurs. Une phrase qui m’a vraiment guidé et profondément marqué est celle-ci, d’Isabelle Stengers : « Un chiffre peut en cacher un autre et il peut même cacher un phénomène pour lequel il n’existe aucun chiffre. » Le facteur humain ne se laisse jamais réduire aux chiffres. Qu’il y ait des chiffres importants à prendre en compte en politique ou en gestion et pilotage d’une équipe est une évidence. Mais réduire l’humain aux seuls chiffres est une aberration grave.
JEF : Une telle position radicale n’est pas vraiment audible dans une école d’ingénieur, n’est-ce pas ?
JEA : Oui, évidemment. Saint-Simon l’a bien annoncé à son époque : « L’administration des choses remplacera le gouvernement des personnes. Les nouveaux notables seront les ingénieurs. » Il est d’autant plus important qu’on sache où se situer par rapport à ces deux paradigmes. C’est en tout cas ce que j’ai essayé de faire en donnant le plus souvent possible la priorité aux personnes par rapport aux choses ; en donnant la priorité à la sagesse plutôt qu’aux lois de la nature ; aux arts plutôt qu’aux technologies ; au sens subjectif plutôt qu’à la vérité objective ; à la compréhension plutôt qu’à l’explication ; aux mots et symboles plutôt qu’aux nombres et formules ; à la singularité plutôt qu’à l’universalité ; à l’action plutôt qu’au modèle ; à l’émotion plutôt qu’à la raison, bref : plutôt à l’esprit de finesse qu’à l’esprit de géométrie.
JEF : Apprendre une langue ne se limiterait donc pas à l’apprentissage d’une « géométrie grammaticale » ?
JEA : Tout comme on ne peut pas apprendre à nager en apprenant par cœur un livre d’anatomie humaine, on doit se lancer un jour dans la piscine pour faire l’expérience de la nage. La parole se passe « en acte », exprime un engagement symbolique fort, sensoriel et incarné qui nous touche profondément. L’enseignant de langue est une sorte de passeur qui aide à renaître dans une autre langue. C’est justement l’expérience de « l’écart entre les langues » dont parle François Jullien qui favorise le développement de l’esprit de finesse.
JEF : Peux-tu développer davantage les raisons qui justifient que nos ingénieurs soient plurilingues ?
JEA : Nous savons depuis Héraclite que nous sommes toujours coupés du réel. Il est par exemple impossible d’expliquer le goût du Camembert à une personne qui n’a jamais mangé ce fromage. Clément Rosset a démontré avec beaucoup d’humour ce dilemme qui caractérise nos efforts de nous faire comprendre. La parole est le « noyau dur » de la condition humaine puisqu’elle est le seul moyen de « combler ce vide » par un sens toujours provisoire. Nos paroles sont des bouteilles jetées à la mer infinie de l’implicite. Les philosophes nous le disent depuis toujours, en commençant avec le fleuve d’Héraclite dans lequel on ne peut pas se baigner deux fois, en passant par Bergson et son livre « L’évolution créatrice » et jusqu’à Bruno Latour qui a proposé juste avant sa disparition récente un « manifeste compositionniste » .
Le monde est toujours en train de se transformer et notre monde commun est toujours à construire, à tous les moments et niveaux de notre existence, au niveau d’un couple, d’une famille, d’une équipe, d’une entreprise et au niveau d’une société toute entière. Si notre monde commun reste toujours à bâtir ou à stabiliser, on peut aussi échouer dans la tentative de le composer. Plus que jamais, ce monde commun à construire est complexe et caractérisé par la présence d’un grand nombre de langues. Chaque langue a son génie propre pour construire ses rapports au monde. C’est seulement par la traduction entre les langues que nous réussirons à capter un maximum des sens multiples de ce monde complexe. D’où la nécessité de multiplier les compétences plurilingues et interculturelles afin de former des médiateurs avertis qui savent traduire langues et langages. Mais attention : il faut toujours avoir à l’esprit qu’il s’agit bien de construire un monde commun et pas du tout un monde exclusif. N’oublions pas que Eichmann a appris l’hébreu afin d’être plus efficace dans l’organisation de la Solution Finale.
JEF : On voit bien que tu es un enfant de la guerre froide et que le passé allemand revient toujours chez toi. Mais ne crains-tu pas que ce rappel à Eichmann soit contre-productif quand il s’agit de défendre un enseignement plurilingue ?
JEA : Ce rappel a pour seul but de nous prévenir contre toute forme de défense superficielle des langues, trop idéaliste pour être vrai. Une langue peut être instrumentalisée (comme une religion, une culture etc.) pour servir les intérêts d’un quelconque pouvoir idéologique. C’était souvent le cas dans l’histoire et ça l’est encore aujourd’hui. Chaque enseignant de langue doit être conscient de cet enjeu éthique de son métier. Il doit se poser le plus honnêtement possible la question : Quelle est la finalité de mon enseignement ? Contribue-je réellement à la composition d’un monde commun, par la gestion de la dynamique de mon groupe-classe, par mes méthodes pédagogiques, par les sujets traités et les supports choisis ? Ou participe-je plus ou moins consciemment au maintien d’un monde exclusif, en considérant par exemple que ma langue soit la seule qui mérite d’être apprise ou qu’elle soit plus importante que d’autres langues présentes dans un même espace social ? Une politique éducative qui favorise le plurilinguisme est le meilleur moyen pour lutter contre toute forme d’hégémonie linguistique et culturelle. Le plurilinguisme est le terreau fertile de l’esprit critique. Je pense qu’il n’est pas nécessaire ici de donner des exemples de ces mondes exclusifs qui sont aujourd’hui défendus par leurs partisans. Notre actualité en est remplie jusqu’à atteindre parfois un niveau insupportable.
JEF : En chargeant l’enseignant de langue d’une telle mission ne risques-tu pas de le décourager ?
JEA : C’est exactement cette mission qui m’a motivé et qui a donné un sens si fort à mon travail ! Je connais beaucoup de collègues qui conçoivent le métier de l’enseignant de cette même façon : composer un monde commun en formant des médiateurs plurilingues. Ils savent, pour le dire avec Michel Serres, qu’au bout du compte « tout apprentissage consiste en un métissage ».
JEF : Finalement, nous avons aussi un monde commun à créer au sein de nous-même pour pouvoir vivre en harmonie et pour pouvoir savourer notre vie. Je te propose pour finir notre causerie d’y associer un troisième JE puisqu’il me semble que nous deux seuls ne sommes pas capables de représenter la diversité de notre for intérieur.
JEA : Oui, c’est vrai. Nous sommes tous des organismes vivants, composés et complexes. Je crois que nous ne pouvons effectivement pas terminer notre échange sans donner la parole à JEI, l’homme inquiet qui est notre colocataire incontournable.
JEF : Merci de nous rejoindre pour parler à trois de ton rapport au monde caractérisé par une très grande inquiétude.
JEI : Malheureusement notre époque ne permet plus d’ignorer des personnages inquiets, pessimistes comme moi. Que puis-je faire pour vous ?
JEF : Explique-nous les raisons de ton inquiétude profonde !
JEI : Je suis très inquiet de l’état du monde dans lequel je vois grandir mes enfants et mes petits-enfants. Permettez-moi de me citer. Dans mes « vœux hors normes pour une époque hors raison » que j’ai envoyés à mes amis et collègues au début de l’année 2021, on peut lire : « Les historiens qui s’intéressent à la longue durée le savent depuis longtemps. Il ne faut pas croire à l’éternel retour pour voir le bégaiement de l’humanité et la répétition des grandes crises à distance de trois ou quatre générations. Un siècle après un grand évènement traumatisant, la transmission vivante est interrompue. Si on ne regarde que les cinq derniers siècles, notre vieille Europe montre bien ce régulier retour dangereux du « sommeil de la raison qui engendre des monstres » (Goya). C’est au début de chaque siècle que des évènements majeurs annoncent des crises et guerres qui s’approchent : les guerres de religion aux 16e et 17e siècles, les guerres de succession du 18e siècle, les guerres napoléoniennes du 19e et la Grande Guerre du 20e avec les traités de paix si vite avortés de Vienne et de Versailles … ! Nous vivons à nouveau aujourd’hui le moment critique d’un début de siècle à hauts risques, comme les somnambules de l’année 1914, dans une phase du sommeil de la raison qui peut produire les pires catastrophes. S’ajoutent aujourd’hui au drame habituel de l’humanité les nouveaux risques technologiques. « Maintenant nous tremblons dans la nudité d’un nihilisme, dans lequel se rejoignent le plus grand pouvoir et le plus grand vide, la plus grande performance et l’absence la plus totale du savoir à quoi bon. » Ce constat de Hans Jonas (dans « Le principe responsabilité » de 1979) n’a rien perdu de sa pertinence, il est au contraire d’une actualité de plus en plus inquiétante. »
JEA : Il est effectivement étonnant d’entendre un tel constat seulement quelques mois avant l’agression de l’Ukraine par la Russie.
JEI : Ces lignes prémonitoires ne sont pas très originales. Il suffit d’être réaliste, de regarder le cours de l’histoire et de ne pas s’abandonner au refoulement des risques qui pèsent sur nous. Comment est-il possible qu’un terroriste d’état comme Poutine ait pu jouer son jeu géopolitique pervers depuis au moins une vingtaine d’années sans que nos hommes et femmes politiques en sentent le souffre ? Nous étions pourtant tous au courant du traitement atroce que le despote du Kremlin réserve à ses adversaires dont personne n’a plus le droit d’ignorer les noms : Alexeï Navalny, Evgueni Roïzman, Vladimir Kara-Murza, Ilia Iachine ou Boris Nemtsov, lâchement assassiné il y a huit ans après avoir averti le monde du projet d’agression de l’Ukraine par la Russie. Il faut craindre que beaucoup d’opposants inconnus subissent le même traitement inhumain.
Mon inquiétude se transforme de plus en plus souvent en colère. Je parle ici d’une colère similaire à celle de Jésus quand il renverse les tables des marchands qui font leur business dans l’enceinte du temple et qui transforment la maison de dieu en « caverne de bandits ». Thomas Müntzer, plus proche de nous, nous le montre aussi. Sa colère n’était-elle pas la seule réponse vraiment adéquate face à l’inacceptabilité de l’extrême pauvreté des paysans de son époque ? Et que fait Spinoza quand il critique le caractère criminel du gouvernement de son époque ? Il est à tel point horrifié par le meurtre incroyablement cruel des opposants du régime au pouvoir, qu’il a l’intention de coller au mur jouxtant le lieu de l’attentat une affiche dénonçant la terreur des « ultimi barbarorum », « des pires des barbares » au pouvoir. Pour agir ainsi, notre philosophe de la joie a dû passer par la tristesse pour exprimer son indignation et pour défendre, à son modeste mais au combien exemplaire niveau, la liberté de pensée.
On connaît d’autres exemples d’une colère justifiée. Est-ce que ce n’était pas une forte colère qui a poussé Georg Elser à vouloir éliminer le mal en la personne de Hitler ? Cette colère s’est transformée en une action lente et déterminée. Il a payé de sa vie sa tentative si courageuse de tuer le « Führer » en novembre 1939 ! Je dis bien en 39 ! Il a préparé son attentat en creusant pendant des semaines chaque nuit un trou dans un pilier sous lequel Hitler devait tenir son discours du 9 novembre. La réalité de la société allemande a rendu Georg Elser malade. La colère a augmenté sa puissance d’action et son courage.
Aujourd’hui il s’agit d’une colère qui répond à l’avidité obscène de ceux qui refusent d’accepter la redistribution d’une partie de leurs richesses totalement insensées vers le reste de la société. Il suffit de lire les travaux de Lucas Chancel sur l’évolution des inégalités dans le monde. L’ordre ultra-néolibérale lancé par le consensus de Washington en 1989 a créé un désordre mondial ahurissant. On peut reprendre la fameuse phrase de Kundera dans « La plaisanterie » en l’appliquant à notre époque : « L’optimisme est l’opium de notre société ultra-néolibérale. »
Je suis effectivement convaincu que la révolte et la colère sont les seules réponses adaptées à cet optimisme stupide qui caractérise beaucoup de discours et de décisions de nos dirigeants concernant par exemple les soi-disant bienfaits de la digitalisation de nos mentalités, de notre système économique totalement déréglé et de nos politiques sociales injustes. Pour ne pas parler de leur hypocrisie quant aux enjeux de santé, d’éducation et du réchauffement climatique. Ce qui est révoltant dans le fonctionnement de nos sociétés, c’est la tendance qu’ont nos gouvernants d’être « faibles avec les forts et forts avec les faibles », comme l’a si bien dit Philippe Corcuff.
JEA : D’où vient chez toi cette révolte si profonde ?
JEI : L’état actuel de notre monde ne suffit-il pas largement pour la justifier ? Peut-être trouve-t-on une partie de la réponse nous concernant dans ce que tu as appelé la dimension biopoétique de notre vie. Je vous rappelle quand-même pourquoi nous nous appelons Jörg. Ce prénom choisi par notre mère n’était pas du tout à la mode en 1955. Mon grand-père Emil, homme né à l’époque de l’empire allemand, n’aimait pas ce prénom. Ma mère voulait certainement plus ou moins consciemment marquer le coup en nous donnant ce prénom deux ans après l’insurrection des Allemands de l’Est du 17 juin 1953.
Il faut savoir que Luther portait le pseudonyme « Junker Jörg » durant la période où il a vécu caché au château de la Wartburg. Luther était obligé de se cacher parce qu’il était condamné à mort, déclaré « vogelfrei », c’est à dire « hors la loi ». N’importe qui avait le droit de le tuer en toute impunité. Pourquoi ? Parce qu’il avait osé dire au pape en 1521 à Worms qu’il ne changerait pas d’avis : « Hier stehe ich, ich kann nicht anders ! » (« Ici je me tiens, je ne peux pas m’empêcher ! ») La résistance est toujours une question de conscience, n’est-ce pas ? Mais là encore, la traduction habituelle du mot allemand « Gewissen » par « conscience » n’est pas satisfaisante. Il s’agit d’une certaine forme de conscience (« Bewusstsein »). « Unser Gewissen », c’est notre conscience du bien et du mal éthiquement fondée, c’est une voix intérieure qui nous parle du besoin d’être juste et de notre responsabilité face à l’inacceptable. « Gewissen » est un mot qui manque cruellement à la langue française.
JEA : Existe-t-il une personne qui représente pour toi un exemple à suivre dans notre époque si trouble ?
JEI : Sans hésiter je dirai qu’il s’agit pour moi de Stéphane Hessel qui était le médiateur par excellence. Je n’oublierai pas ma rencontre très furtive avec lui lors d’une réception à l’ambassade allemande. En me retournant, mon verre à la main, je me retrouve par hasard face à lui, en grande discussion avec Simone Veil. Très vite, les deux se sont évidemment éloignés, me laissant seul et muet. C’était un cadeau, pour le témoin passif que j’étais, de ressentir à travers leur court échange toute la complicité et l’amitié qui caractérisait leur relation.
Stéphane Hessel était aussi à l’origine de la création des Sections internationales de Sèvres en 1962 pour lesquelles j’ai eu le plaisir de travailler en tant qu’enseignant entre 1992 et 2004. Voilà quelqu’un qui nous montre, par la cohérence éthique de sa vie, la direction que nous devons tenter de suivre. D’origine allemande, devenu français, résistant, déporté, ambassadeur, infatigable défenseur de toutes sortes de « sans-papiers » et lanceur d’alerte avec son manifeste « Indignez-vous ! ». Quelle vie exemplaire !
Oui, indignons-nous ! Pour le dire avec les mots de Jean Malaurie qui nous encourage aussi avec sa vie exemplaire de résistant contre l’ordre nazi et plus tard avec son engagement en faveur des Inuit de Thulé : « Ne pas devenir un peuple de fourmis, manipulé par le verbe, l’image et l’informatique. Oser, résister et s’aventurer. » On ne saurait mieux conclure notre petite causerie !
JEF : Merci à vous deux pour cet échange franc entre nous trois.
JEA : Les questions m’ont aidé à faire preuve d’élasticité et à voir plus clair en moi, en nous.
JEI : Merci à vous de m’avoir associé à cette causerie entre amis ! Portez-vous bien ! Que notre indignation génère d’autres petites causeries entre amis !
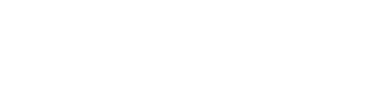

Responses